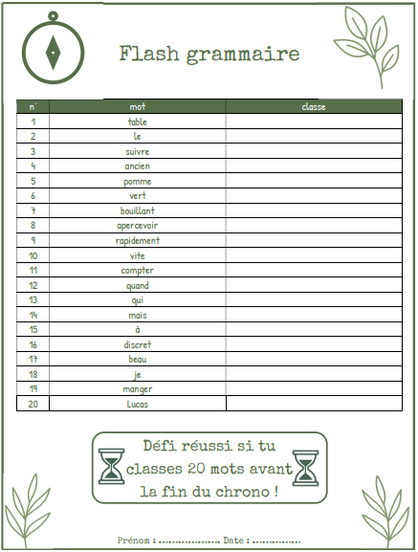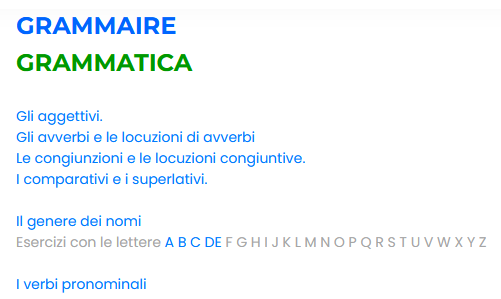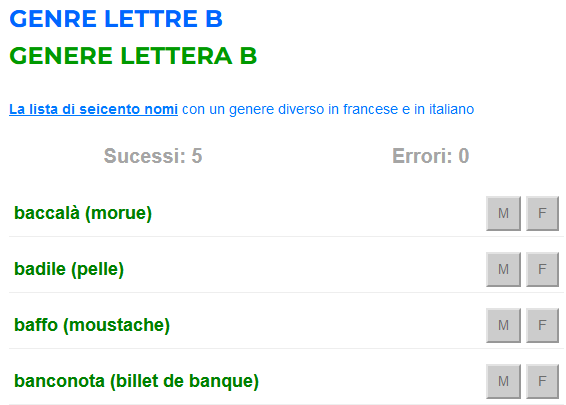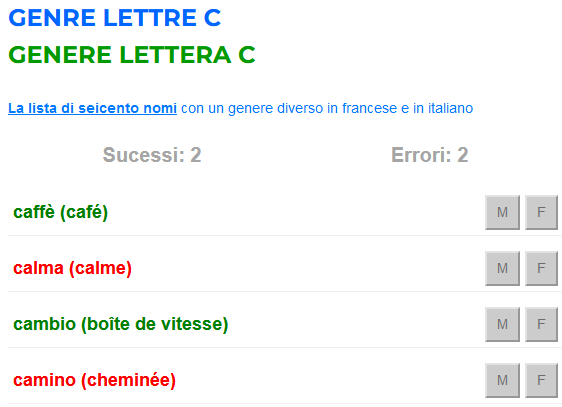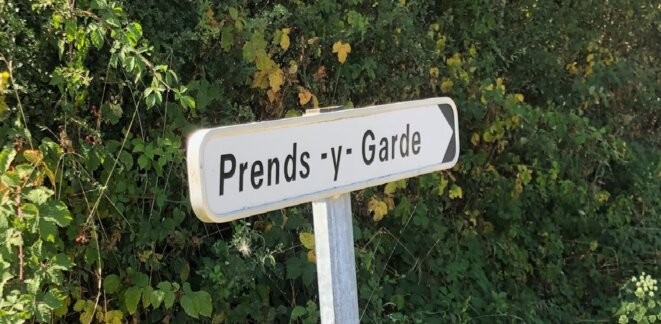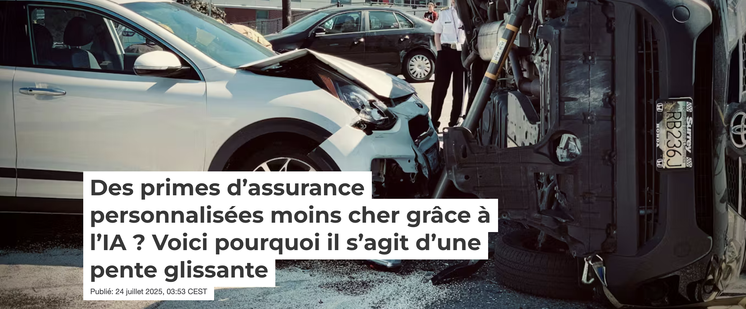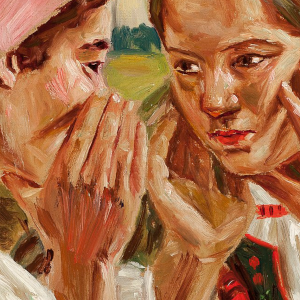Les compléments d’objet indirects : aspects syntaxiques
Plan de l’article :
I. Définition générale
II. Préposition inaugurale et nature syntaxique
III. Règles de transformation
IV. Conclusions et bibliographie
I. Définition générale
Que sont les compléments d’objet indirects (COI) ?
Les compléments d’objet indirects (COI) sont reconnus par la tradition grammaticale comme des compléments essentiels du verbe, à l’aune des compléments d’objet directs (COD). Ils se caractérisent, au regard de ces derniers, par leur syntaxe particulièrement et notamment par la préposition inaugurale qui les introduit (1).
(1) Je parle à Jean.
Leur repérage, cependant, est plus complexe dans la mesure où ils ressemblent, superficiellement, à d’autres types de groupes prépositionnels, notamment la famille des compléments dits « circonstanciels », des compléments à valeur scénique ou de certains compléments de phrase, qui partagent d’ailleurs parfois certaines de leurs propriétés. Ces problèmes ont été, en grammaire scolaire, longtemps indépassables : et il était fréquent que les manuels identifient comme des COI des compléments circonstanciels, et réciproquement.
Historiquement, il y a effectivement une relation entre ces compléments : un certain nombre de COI ont été, dans l’histoire de la langue française, des compléments circonstanciels qui ont été progressivement intégrés dans la valence verbale. En effet, un certain nombre de ces compléments, parce qu’ils accompagnaient très souvent un verbe et étaient cohérents avec son sémantisme, ont fini par développer une relation de solidarité assez forte avec le verbe et devenir un de ses actants.
Le COI se définit donc comme un complément essentiel du verbe, introduit par une préposition et distinct, par ses propriétés, des autres types de groupes prépositionnels.
Le lien, cependant, entre le COI et le verbe est plus lâche qu’avec un COD ou un attribut, dans la mesure où l’on a précisément besoin d’une préposition pour assurer la relation avec le verbe. En ce sens, et au-delà des paramètres syntaxiques que l’on énumèrera ci-après, le paramètre sémantique est essentiel pour identifier les COI. C’est en effet le contexte, et la relation de sens entre le verbe et le COI, qui orientera l’analyse.
Ainsi, un complément locatif du type à l’école sera bien un COI du verbe aller, dans la mesure où le sens du verbe suppose un complément indiquant le point d’arrivée du mouvement ; en revanche, il sera davantage un complément circonstanciel, à valeur scénique, derrière un verbe comme parler puisque son sémantisme, ou son « drame » pour reprendre la formule de Tesnières, n’implique pas une précision locative au regard du schéma actanciel du verbe où l’on attendrait davantage la personne à qui l’on parle, ou le sujet de la discussion.
(2a) Je vais à l’école (COI)
(2b) Je parle à l’école (circonstant) de mathématiques (COI)
Dans cet article, nous ne reviendrons pas sur ces aspects sémantiques, qui feront l’objet d’un développement approfondi dans un futur billet sur les circonstants. Il y a, en revanche, des éléments syntaxiques assez stables sur lesquels il est bon de revenir ici pour identifier les COI.
II. Préposition inaugurale et nature syntaxique
La préposition introduisant le COI demeure l’un de ses traits fondamentaux : c’est ce qui le distingue notamment des COD et des attributs. En revanche, la nature du COI peut être diverse. On peut trouver là des noyaux nominaux (substantifs ou pronoms), des infinitifs (forme « quasi-nominale » du verbe) ou des subordonnées, complétives ou intégratives (dites encore « indéfinies »).
(3a) Je parle de Pierre / de moi (noyau nominal)
(3b) Je parle de partir (noyau infinitif)
(3c) Je parle de ce que je veux (noyau subordonnée complétive)
(3d) Je parle de qui je veux (noyau subordonnée indéfinie)
Les prépositions introduisant des COI sont également multiples. Outre la triade à/de/en, composée des prépositions les plus usuelles du français, nous pouvons également trouver, toujours selon le sémantisme du verbe, d’autres prépositions au sens plus transparent comme sur (je m’assois sur une chaise), contre (je m’appuie contre le mur) ou pour (je vote pour mon candidat). On retiendra cependant deux éléments les concernant :
(i) D’une part, le choix de la préposition est contraint par le verbe. Si certains d’entre eux autorisent, avec différents effets de sens, une certaine variation, la chose est rare en français.
(4a) Je parle à/de/pour Jean.
(4b) *Je vais selon l’école
(ii) D’autre part, il faut que le sens de la préposition, dans le cas où celle-ci n’est pas à, de ou en, soit cohérent avec le verbe. Ainsi, on acceptera volontiers une préposition locative avec un verbe de mouvement (5a), mais il sera plus difficile d’employer une préposition liée au but ou à l’intention (5b).
(5a) Il parvient jusqu’au sommet.
(5b) *Il parvient pour le sommet.
C’est précisément parce qu’il y a cohérence entre le sens du verbe et la préposition qu’historiquement, la réanalyse du circonstant en COI a pu se faire progressivement. On notera d’ailleurs que la préposition permet de distinguer divers sens à un verbe, en fonction du mode de construction du complément :
(6a) Je connais Jean.
(6b) Le juge connaît de l’affaire (= « être capable de juger l’affaire »)
Parfois encore, le choix de la préposition oriente l’interprétation, avec des nuances plus ou moins fines. On a vu récemment, dans la langue moderne, se stabiliser une opposition entre habiter à Paris et habiter sur Paris, la préposition sur indiquant une localisation plus lointaine ou plus vague (à Paris = intra-muros ; sur Paris = dans le voisinage de Paris, en banlieue proche par exemple). Aussi, l’usage continue de modifier la valence verbale en s’appuyant sur la complexité des prépositions, pour déterminer des effets de sens nouveaux.
III. Règles de transformation
Certaines règles de transformation syntaxique permettent également d’orienter l’analyse, et de distinguer les « vrais » COI, c’est-à-dire les actants du verbe, d’autres types de groupes prépositionnels, en jouant sur le lien syntaxique que le COI entretient avec son verbe. Notamment les COI peut être pronominalisés en position préverbale :
(7a) Je parle de Jean <=> J’en parle.
(7b) Je parle lentement <≠> *Je le parle.
(7c) Je parle à voix basse <≠> *J’y parle
Au regard des COD ou des attributs en revanche, les règles de pronominalisation de COI sont un peu plus complexes. On doit notamment distinguer trois régimes de transformation, en fonction et de la nature de la préposition inaugurale, et du statut référentiel du COI selon le paramètre +/- humain. On distinguera alors :
(i) Un premier régime avec les COI introduits par à. La pronominalisation s’effectue alors soit par y pour les COI -humain (8a), soit par lui pour les COI +humain (8b). Dans ce dernier cas, le pronom lui ne marque pas le genre masculin ou féminin, que ce soit au niveau grammatical ou ontologique.
(8a) Je réponds à son courrier <=> J’y réponds.
(8b) Je réponds à Marie <=> Je lui réponds.
Dans certains cas, la transformation peut s’effectuer en conservant un GP introduit par à, suivi de lui/elle(s)/eux/ça, en parallèle de la pronominalisation en y. C’est un choix fait pour lever, occasionnellement, une ambiguïté interprétative. Ainsi, (9a) est tant la transformation de (9b) que de (9c).
(9a) J’y pense.
(9b) Je pense à l’avenir (Je pense à ça)
(9c) Je pense à mes enfants (Je pense à eux)
On notera également que y tend néanmoins à se spécialiser dans le non-humain : c’est l’interprétation préférentielle, et certaines variétés diatopiques (dans le lyonnais par exemple) étend cette propriété au COD, pour distinguer la référence des compléments au regard du pronom objet le/la (Je le [Jean] vois vs. J’y [la table] vois).
(ii) Les COI introduits par de se pronominalisent tous par en. Ce pronom est véritablement lié au mot-forme de, puisqu’on le retrouve également pour la transformation des COD introduits par le partitif ou le déterminant indéfini de. Il faut donc veiller à ne pas confondre les formes entre elles, et de vérifier le statut de de, préposition ou déterminant.
(10a) Je parle de Jean <=> J’en parle (COI)
(10b) Je veux de l’eau <=> J’en veux (COD)
(iii) Enfin, les autres types de COI se pronominalisent sous la forme préposition + pronom pour les animés :
(11a) Jean tourne autour de Marie <=> Jean tourne autour d’elle.
(11b) Je compte sur Jean <=> Je compte sur lui.
Ou, pour les inanimés, par un rappel de la préposition « seule », sans le reste du syntagme.
(12) J’ai voté contre la loi <=> J’ai voté contre.
L’identification de ces derniers compléments comme COI est parfois discutée, mais deux arguments peuvent être avancés pour conduire l’analyse : d’une part, la pronominalisation avec lui est encore autorisée pour les animés (13a), même si certaines grammaires associent la transformation à un niveau de langue populaire ou relâchée. D’autre part, le détachement en tête d’énoncé est senti comme incorrect ou maladroit (13b). Or, le COI étant un complément verbal, on ne peut le déplacer librement comme on peut le faire avec un complément à valeur scénique.
(13a) Jean lui tourne autour.
(13b) ?Autour de Marie, Jean tourne.
Ce test de déplacement en tête d’énoncé est d’ailleurs crucial. Si on peut toujours le faire pour les COI, on notera qu’il demande un rappel par cataphore d’un pronom en position préverbale pour assurer la grammaticalité de l’énoncé, ce qui n’y pas le cas des compléments à valeur scénique (14).
(14a) (À) Jean, je lui parle / ?(À Jean), je parle
(14b) Sur le quai, j’ (*y) attends.
La complexité de ces analyses, et le fait qu’elles fassent appel à notre sentiment de langue, empêche cependant d’avoir des certitudes absolues pour certains compléments. En diachronie de même, il est pour ainsi dire impossible de mener la discussion, comme nous ne pouvons pas faire appel à ce sentiment linguistique.
IV. Conclusions et bibliographie
Les COI nous rappellent, si besoin était, que rien dans l’analyse de langue n’est absolument indiscutable : les phénomènes grammaticaux ne sont pas des équations mathématiques à résoudre, et une part d’interprétation sera toujours nécessaire dans l’analyse même si des tests et des outils nous permettent d’orienter les discussions. Les COI sont des témoins privilégiés de cette observation, comme ils se situent à la frontière entre les actants du verbe et les circonstants, sans même rentrer dans le terrain, difficile, de l’évolution historique ou de la variation géographique.
Parmi les références que nous pouvons donner :
- Jacqueline Pinchon a écrit, en 1972, une étude sur Les pronoms adverbiaux en et y, hélas non réédité. Sa consultation permettra cependant d’y voir plus clair sur cette question épineuse.
- Outre les références données dans l’article sur les prépositions, qui serviront également pour la discussion, on lira avec attention l‘article de Le Querier (1999), sur Fin de partie de Beckett, pour un point de vue stylistique/sémantique sur la question.
Site sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) : partage autorisé, sous couvert de citation et d’attribution de la source originale. Modification et utilisation commerciale formellement interdites (lien)
#complément #complémentCirconstanciel #complémentDObjetDirect #complémentDObjetIndirect #grammaire #MathieuGoux #pronom #Syntaxe #valenceVerbale #verbe