Le Département de Maine-et-Loire se porte volontaire pour expérimenter l’allocation sociale unique
☆
Contre le piège de l'Allocation Sociale Unique (#ASU)
➡️ https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-4749 n°4749
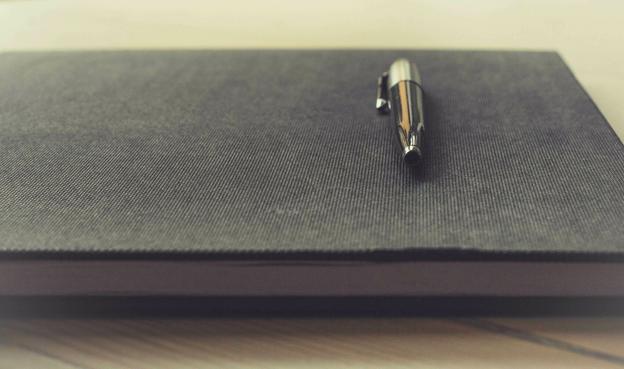
Contre le piège de l'Allocation Sociale Unique ASU - Contre le piège de l'Allocation Sociale Unique ASU - Plateforme des pétitions de l’Assemblée nationale
Nous, citoyennes et citoyens, résidentes et résidents, organisations de la société civile, acteurs de la solidarité et de la dignité humaine, exprimons notre opposition la plus ferme au projet de loi visant à instaurer une Allocation Sociale Unique (ASU). Une telle réforme, présentée sous le masque de la simplification administrative ou de la lutte contre la fraude sociale, porterait une atteinte grave aux fondements de notre État social, tel qu’issu du préambule de 1946 et de l’héritage du Conseil National de la Résistance. Elle risquerait d’accroître durablement la pauvreté, l’exclusion et les inégalités en France. I. Une réforme contraire aux exigences constitutionnelles et au droit international 1. Une menace directe contre les garanties constitutionnelles : dignité, égalité, solidarité Atteinte au droit à des moyens convenables d’existence Le préambule de 1946, qui a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, reconnaît le droit pour toute personne « ne pouvant subvenir à ses besoins » d’obtenir de la Nation « des moyens convenables d’existence ». Si l’ASU se traduit, comme le laissent présager ses paramètres publics, par : une fusion des aides conduisant mécaniquement à une baisse du montant total versé ; des conditionnalités plus strictes (obligations d’activité non rémunérée, sanctions élargies, contrôles renforcés) ; une exclusion indirecte de publics présentant des vulnérabilités psychiques, sociales ou administratives ; alors la réforme pourrait être considérée comme incompatible avec ce standard constitutionnel minimal de dignité. Le Conseil constitutionnel a déjà jugé que les prestations sociales sont soumises au principe de non-régression de la protection sociale (décisions n° 2000-437 DC, n° 2018-768 DC). Une baisse substantielle des minima pour motifs budgétaires serait donc constitutionnellement fragile. Principe d’égalité et rupture d’égalité devant les charges publiques L’article 1er de la Constitution impose que la loi n’opère pas de ruptures d’égalité injustifiées. L’ASU vise principalement un public déjà vulnérable, en lui imposant un régime plus strict que celui appliqué à d’autres catégories sociales bénéficiant d’avantages fiscaux ou d’aides ciblées. La fraude aux prestations sociales représente selon la Cour des comptes moins de 3 % des montants versés, tandis que la fraude fiscale atteint entre 80 et 100 milliards d’euros par an (estimation de 2023 reprise dans les travaux parlementaires). Faire peser l’effort principalement sur les plus pauvres constituerait une rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques. 2. Une violation de plusieurs engagements internationaux de la France PIDESC – Article 11 : droit à un niveau de vie suffisant Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a rappelé, dans ses observations finales (2016) et dans ses Directives de 2007, le principe de non-régression des droits sociaux. Toute réforme ayant pour effet prévisible : la réduction du montant des minima sociaux, la difficulté accrue d'accès aux droits, des conditionnalités contraires à la dignité, constituerait une mesure régressive prohibée, sauf justification impérieuse - absente ici. Charte sociale européenne révisée : Articles 12 et 30 Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a déjà condamné plusieurs États pour insuffisance des minima sociaux (notamment la décision Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) c. Pays-Bas, 2014). Le montant minimal doit permettre un niveau de vie décent, c’est-à-dire couvrir : le logement, l'alimentation, les soins, l'accès aux services essentiels. Une ASU abaissant les prestations sous ce seuil pourrait exposer la France à une condamnation similaire. II. Les alertes concordantes des organisations internationales et ONG 1. Les mises en garde du Rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté Les rapporteurs successifs (Philip Alston en 2019, Olivier De Schutter depuis 2020) ont explicitement averti contre : les réformes conditionnant l’aide sociale à des activités non rémunérées (workfare), jugées incompatibles avec les droits humains ; les politiques « punitives » envers les pauvres, créant un climat de suspicion généralisée ; le non-accès aux droits du fait de procédures complexes ou humiliantes. Dans son rapport thématique de 2021, De Schutter souligne que les systèmes unifiés d'aide sociale qui réduisent les montants ou augmentent les contrôles renforcent la pauvreté au lieu de la diminuer. Le Rapporteur spécial a exhorté la France à garantir des prestations « suffisantes, accessibles, inconditionnelles pour les publics les plus vulnérables ». Ce diagnostic correspond point par point aux risques induits par l’ASU. 2. Les analyses d'Oxfam : inégalités en France et effets des politiques de réduction de dépenses sociales Les rapports Oxfam sur les inégalités (notamment « Les inégalités en France : état des lieux », éditions 2018–2023) montrent que : les 10 % les plus riches ont capté l’essentiel de la croissance du patrimoine depuis 20 ans ; la fortune des milliardaires français a été multipliée par 4 depuis 2009 ; la réduction des dépenses sociales accroît mécaniquement le taux de pauvreté, surtout chez les familles monoparentales, les personnes migrantes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Oxfam souligne régulièrement que la France souffre davantage d'un problème d’injustice fiscale que d’un problème de « coût de la solidarité ». Dans ce contexte, l’ASU apparaît non comme une réforme neutre, mais comme une mesure d’austérité ciblée, faisant porter le poids des économies publiques sur les plus vulnérables, tout en épargnant les secteurs les plus favorisés. III. Une réforme contraire à l’héritage du Conseil National de la Résistance Le système français de solidarité repose sur le principe que la protection sociale est un droit, non une faveur conditionnelle. L’ASU, en fusionnant et en diminuant les minima sociaux, rompt avec : l’esprit du programme du CNR : « un plan complet de sécurité sociale visant à garantir à tous les citoyens des moyens d’existence » ; la jurisprudence constante reconnaissant la finalité sociale de ces prestations comme partie intégrante de la dignité humaine. Une telle régression, motivée par des impératifs budgétaires et non par un souci de justice sociale, serait une rupture historique et morale. Conclusion : Appel solennel à la mobilisation Nous appelons l’ensemble des forces humanistes, politiques, syndicales, associatives et citoyennes à refuser ce projet. L’Allocation Sociale Unique n’est pas une simple réforme technique : elle représente une atteinte profonde à la solidarité française, à la dignité humaine et aux engagements constitutionnels et internationaux de notre Nation. Nous demandons aux députés de s’opposer fermement à ce texte, de protéger les filets sociaux garantissant la dignité de chacun, et de réaffirmer que la France n’a pas vocation à mener une politique de défiance envers ses citoyens les plus vulnérables. La solidarité n’est pas une charge : c’est un devoir. La dignité n’est pas négociable : c’est un droit.
